L'expédition d'Egypte
A la mi-mars 1798, plusieurs enseignants de l'Ecole polytechnique, jeunes ou savants réputés, reçoivent du Directoire une convocation mystérieuse leur demandant de se tenir prêts pour une mission lointaine non précisée. Joseph accepte et choisit son remplaçant (Garnier).Il quitte Paris pour Lyon en diligence rapide le 1er floréal an VI (20 avril) après s'être muni de bons livres. L'équipe embarque ensuite sur le Rhône, sans doute à Vienne ou Condrieu. Elle parvient à Toulon où une flotte de guerre est réunie. Un imposant lot d'appareils scientifiques est du voyage.
Fourier est hébergé sur le Franklin, ainsi que le général Kléber, avec qui il se lie. La flotte appareille le 19 mai 1798 ; elle comprend, après sa jonction avec une escadre à Malte, 400 navires dont 13 vaisseaux de ligne [entendez : de guerre] alignant 1026 canons. Commandé par Bonaparte[1], ce convoi de 10 km de long réussit à échapper aux Anglais, contre qui la France est en guerre.

L'activité scientifique de Fourier en Egypte.
|
Joseph Fourier est d'abord affecté au secteur du petit port de Rosette, près d'Alexandrie. Il est chargé par Bonaparte de publier un journal, le Courrier de l'Egypte, relatant les faits militaires et l'action civilisatrice de l'expédition (il publiera 116 numéros). La majeure partie du matériel scientifique a été coulée dans le désastre d'Aboukir : les ingénieurs et savants sont au début désœuvrés. Après les premières victoires, ils pourront parcourir le pays, mais toujours sous la protection de l'armée. Leur sécurité sera toujours précaire et beaucoup de scientifiques seront tués.
 Fourier présente rapidement des mémoires devant cette société : certains, bien sûr, abstraits, en commençant par la résolution des équations algébriques ; mais aussi d'autres, beaucoup plus pratiques, comme une étude d'une roue motrice exposée à l'usage du vent, une éolienne avant l'heure, qui ne suscitera guère d'intérêt. En fait, il s'intéressera à de nombreux sujets et passera même, pour certains, comme un touche-à-tout. Membre éminent de la commission chargée de reconstruire l'aqueduc de la citadelle du Caire, il se plongera dans les archives et se découvrira une nouvelle vocation, celle d'historien. Quand, en juillet 1800, le général Menou veut recréer la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, c'est encore Fourier qui sera chargé de son organisation.
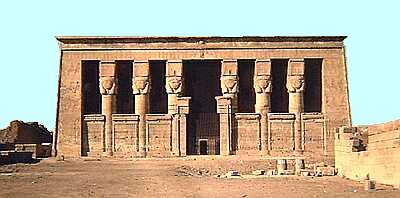
 La situation militaire n'est pas sûre. Bonaparte veut poursuivre les chefs guerriers, les mamelouks, jusque dans leur refuge, la Palestine et la Syrie. Cette expédition aura un succès mitigé (il sera obligé de lever le siège de St-Jean-d'Acre et la peste sévira dans son armée). A la suite de réformes françaises concernant la propriété terrienne en Egypte et la répartition de l'impôt, les classes privilégiées se révoltent au Caire (21 octobre 98) : 300 français sont tués, dont plusieurs généraux et dix fois plus d'Egyptiens. Durant l'absence de Bonaparte, Fourier est chargé des relations avec le Diwan, ou Conseil suprême, assemblée d'ulémas (religieux) et de notables qui supervise les conseils locaux. Ce rôle, très important, correspond en fait à la fonction de préfet, ou de gouverneur, de la Basse-Egypte. Comme il est en plus le chef incontesté des scientifiques, il réunit pratiquement tous les pouvoirs, politique, juridique et intellectuel, excepté le commandement militaire. Il sait négocier et apaiser les rivalités. Quand Bonaparte, de retour, lui demande comment il fait, il répond : Je prends l'épi dans le bon sens.
Laïc, Joseph Fourier tient cependant à respecter la religion locale, comme d'ailleurs l'a prescrit Bonaparte. Nombre de ses amis voudraient apporter en Egypte toutes les conquêtes des Lumières, y compris la lutte contre l'obscurantisme. Mais il connaît l'imbrication entre religion et politique en Orient et il rassure les notables sur ce sujet : les Français n'imposeront pas la laïcité.
|
Le lendemain de cette séance mémorable, Bonaparte rentre en France secrètement après avoir nommé Kléber comme successeur. Le rôle de Fourier, très ami avec Kléber, ne faiblit pas : il sert d'intermédiaire dans les rivalités et les conflits internes, le général le charge même de contacts officieux avec l'armée ottomane ennemie. Le travail scientifique se poursuit, on prépare cependant la rédaction du rapport final : Fourier est élu à la quasi unanimité des scientifiques comme coordonnateur et rédacteur de sa préface.
La perte de l'Egypte
La situation devient difficile ; les scientifiques doivent se replier à Alexandrie sur le bateau l'Oiseau (24 janvier 1800). Les Anglais bloquent la mer, mais Kléber redresse la situation en remportant la bataille d'Héliopolis en mars et en reprenant le Caire révolté. C'est Fourier qui négocie la paix avec les beys. Kléber et lui envisagent de quitter l'Egypte, mais dans l'honneur. Hélas, Kléber est assassiné le 14 juin 1800 (c'est Fourier qui prononce son éloge funèbre) ; le général Menou, converti à l'Islam et plus belliqueux, lui succède. Le travail scientifique reprend au Caire et Fourier, qui est apprécié de Menou, reprend son rôle officieux de chef politique de l'Egypte.
Début 1801, les Anglais reprennent l'offensive : ils débarquent à Aboukir et battent l'armée française à Canope le 22 mars 1801. La situation est critique. La dernière séance de l'Institut a lieu le lendemain ; la moitié des mathématiciens manque à l'appel : ils sont morts ou ont quitté l'Egypte. La peste ronge le Caire. Fourier est convaincu qu'il faut partir, il négocie, avec Menou et avec les Anglais, le rapatriement des scientifiques, qui, le 10 juin, se réfugient à nouveau sur l'Oiseau en Alexandrie. Les négociations sont difficiles de part et d'autre, parce que Menou ne veut pas laisser les scientifiques emporter quoi que ce soit d'utile aux Anglais, donc pas de vestiges. L'Oiseau appareille le 11 juillet, mais, malgré les accords passés, il est aussitôt arraisonné par les Anglais et renvoyé au port, tandis que Fourier est gardé en otage. Champollion-Figeac écrira à propos de ce fait sans précédent : les Anglais ont capturé une cargaison de savants ! Finalement, Menou accepte les conditions des Anglais (livraison de tous les vestiges recueillis, dont la pierre de Rosette) et se rend le 3 septembre 1801. Le corps expéditionnaire, ou ce qu'il en reste (40%), est débarqué par les Anglais à Toulon (après la quarantaine obligatoire) le 19 novembre.
L'occupation de l'Egypte par la France aura duré un peu plus de 3 ans. L'Egypte n'est pas devenue colonie française, l'influence anglaise s'y est même renforcée. Les grands travaux réalisés ne seront pas durables. Mais la prospection scientifique aura un retentissement considérable : l'Europe va faire la connaissance de l'antique civilisation égyptienne.
Notes
2. Bonaparte avait refusé de pénétrer dans les pyramides, parce qu'il fallait le faire en rampant. Retour au texte
3. Pierre de granit noir à grain fin, d'environ 1,20 m sur 0,9 et 0,30 d'épaisseur. Sur l'une des faces, polie, étaient gravées des inscriptions en trois langues, grec, égyptien démotique et hiéroglyphe (voir page JF.Champollion). On soupçonna vite qu'il s'agissait d'un même texte en trois versions différentes. Retour au texte
| Page précédente | Page suivante |
